- jeu, 2010-10-21 17:51
- 3
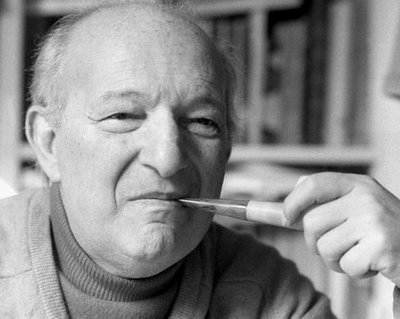 « Pour qui se fie aux apparences, la production capitaliste contient en effet un mystère. Pour nous en tenir en un schéma très simplifié, Jean, possesseur d’une somme d’argent X, la fait fonctionner comme capital. Au terme de ce procès, il perçoit un certain profit. D’où vient ce profit ?
« Pour qui se fie aux apparences, la production capitaliste contient en effet un mystère. Pour nous en tenir en un schéma très simplifié, Jean, possesseur d’une somme d’argent X, la fait fonctionner comme capital. Au terme de ce procès, il perçoit un certain profit. D’où vient ce profit ?
Selon toute apparence, du seul fait qu’il ait fonctionné comme capital dans la production, l’argent semble avoir produit un rejeton, s’être augmenté d’une fraction de lui-même. Comment est-ce possible ? Comment X s’est-il transformé en X+h ? Il est essentiel de poser ce problème si l’on veut comprendre la nature de la production capitaliste : car il est bien clair que si la somme engagée X s’éteignait complètement dans le procès de la production des marchandises non seulement le possesseur d’argent ne trouverait aucun intérêt à produire, mais encore la production s’arrêterait à son premier acte. Comprendre l’origine de cet accroissement h, c’est donc se rendre capable de comprendre le secret du mouvement et du renouvellement de la production capitaliste. Tout le premier livre du Capital est consacré à l’explication de cet apparent mystère1. Les marchandises : valeur d’usage et valeur d’échange Dans le mode de production capitaliste, le point d’arrivée de l’activité économique est le marché. On produit en vue de l’échange ; et l’enrichissement de la société trouve son expression dans le volume des échanges. Les objets qui sont soumis à l’échange se nomment des marchandises. Il est donc naturel – et c’est le chemin suivi par Marx – de commencer l’enquête par l’analyse de la marchandise. Avant de paraître sur le marché, les marchandises sont d’abord des objets utiles qui tiennent leur utilité de la relation qui s’établit entre leurs propriétés naturelles et les besoins humains. Un vêtement couvre le corps ou l’orne. Le pain satisfait la faim, etc. Une marchandise trouve donc d’abord une valeur pour son utilisateur potentiel. Cette forme de valeur se nomme valeur d’usage. Considérées selon leur valeur d’usage, les marchandises sont, entre elles, incomparables. Elles demeurent qualitativement distinctes : on ne peut substituer le fer au blé, ni l’uranium au pain. Considérées sous ce rapport, il n’existe entre elles aucune relation d’équivalence, si l’on excepte cette condition, essentielle mais très vague, qu’elles doivent toutes, à la limite, satisfaire quelque besoin humain. Pourtant le marché est ce lieu où les marchandises sont traitées comme équivalentes : elles s’expriment en fonction les unes des autres de telle sorte que chacune est un multiple ou une fraction de toutes les autres. Si, prises comme valeurs d’usage, les marchandises ne sont pas substituables, elles le deviennent en tant que valeur d’échange, une quantité déterminée de l’une étant équivalente à une quantité donnée de l’autre. Quelle est la « propriété » qui, étant commune à toutes les marchandises, permet de les considérer comme substituables sous l’aspect de la quantité – et d’exprimer chacune comme multiple ou fraction des autres ? Une analogie nous fera comprendre la nature du problème posé. Il existe une « propriété » commune à toutes les marchandises Il en est de la valeur d’échange des marchandises comme de la longueur des lignes, de l’aire des surfaces, du volume des solides. Ces figures sont comparables dès qu’on les considère comme fractions d’un quantum homogène, au sein duquel leurs qualités ont disparu : elles cessent pour ainsi dire d’être triangle, cube, pour devenir aire ou volume. Le même problème doit se poser pour la valeur d’échange des marchandises. Quel est ce substrat homogène qui, se retrouvant dans toutes les marchandises, permet de les évaluer les unes en fonction des autres ? Arrivé à ce point, Marx n’a pas renié sa jeunesse. Nous l’avons vu plus haut : l’activité humaine est essentiellement travail. Tous les biens économiques contiennent du travail, en ce sens qu’ils ont tous exigé l’activité transformatrice des hommes. Valeur et travail Mais la question qui se pose pour la valeur d’usage des marchandises (renvoyant à leurs qualités propres) se pose aussi pour les travaux humains. Ces travaux sont qualitativement distincts. D’une part, ils sont produits par des individus distincts. Et d’autre part, ils font appel à des activités et à des techniques différentes : cueillir, chasser, labourer, extraire le minerai sont des travaux qui, du point de vue de leur qualité, sont aussi incomparables que le sont leurs produits. Cependant (et là est le pas décisif) si, dans la marchandise, nous faisons abstraction de sa valeur d’usage, nous abolissons sa qualité. Mais si nous faisons abstraction des qualités spécifiques de chaque marchandise par là même en les rapportant au travail qui les a produites, nous faisons abstraction des caractères particuliers de ce travail, lesquels concernaient précisément les propriétés singulières de la marchandise produite. La même abstraction qui nous porte à négliger les qualités des marchandises pour nous en tenir seulement à leur aspect quantitatif nous contraint à ne considérer dans le travail déposé en elles que l’aspect quantitatif. C’est pourquoi Marx énonce : la grandeur de la valeur d’une marchandise se mesure « par le quantum de la substance créatrice de valeur » contenue en elle, par le « quantum de travail »2. Que veut dire l’expression « quantum de travail » ? Si on appelle « quantum » ce qui est susceptible d’égalité, de plus ou de moins, on pourrait dire que des travaux différents sont quantitativement comparables en ce qu’ils sont, par exemple, plus ou moins pénibles, plus ou moins qualifiés et que, par conséquent, leurs produits (les marchandises) doivent avoir d’autant plus de « valeur » que ces travaux sont plus pénibles ou plus qualifiés. L’absurdité d’une telle réponse apparaît aisément sur un exemple. Rien ne serait plus pénible, pour moi, qui ne suis pas cordonnier, que de fabriquer une paire de chaussures. Si, par impossible, je parvenais avec beaucoup de peine à en fabriquer une, aurait-elle plus de valeur pour cela ? Nullement. Elle vaudrait ce que valent les chaussures sur le marché. Et j’aurais perdu mon temps pour peu de chose. Quel est alors cet aspect quantitatif qui se retrouve homogène à travers tous les travaux comme l’espace à travers toutes les figures ? Autrement dit, sous quelle forme le travail est-il présent dans la valeur d’échange des marchandises ? Il suffit de réfléchir à l’exemple cité plus haut pour apercevoir la réponse : il y est présent sous la forme du temps de travail nécessaire à leur production. C’est le temps de travail, sa durée, qui mesure la quantité de travail et donc la valeur d’échange des marchandises. Le temps de travail social est la mesure de la valeur des marchandises Mais ces mots « temps de travail » restent encore imprécis. Le temps de travail nécessaire à la production d’une marchandise peut varier d’un individu à l’autre, d’une région à l’autre. Il nous faut compléter cette formule en écrivant : la valeur d’échange d’une marchandise s’exprime par le temps de travail socialement nécessaire à sa production. « Socialement nécessaire » signifie ici deux choses : d’une part, qu’il faut tenir compte du niveau des forces productives ; d’autre part, qu’il faut tenir compte des conditions moyennes d’intensité et d’habileté technique propres à telle espèce de travail, dans la société considérée. Le temps de travail socialement nécessaire représente une moyenne propre à telle ou telle société, moyenne en fonction de laquelle les oscillations individuelles sont négligeables. La force de travail du producteur individuel est alors considérée comme une composante homogène de la force de travail anonyme de la société tout entière. Un exemple donné par Marx fait bien comprendre la chose : « Après l’introduction en Angleterre du tissage à vapeur, il fallut peut-être moitié moins de travail qu’auparavant pour transformer en tissu une certaine quantité de fil. Le tisserand anglais, lui, eut toujours besoin du même temps pour opérer cette transformation ; mais, dès lors, le produit de son heure de travail individuel ne représenta plus que la moitié d’une heure sociale de travail et ne donna plus que la moitié de la valeur première3. » La force de travail, ... Or, dans le système capitaliste, la force de travail de l’ouvrier est une marchandise. Cela veut dire que le mode de production bourgeois fonctionne de telle manière qu’il donne naissance à une classe d’hommes dont la seule issue, pour pouvoir subsister, est d’offrir sur le marché le seul bien qui leur appartienne en propre : leur force de travail. Pour que cela soit possible, il faut que les travailleurs soient des personnes libres, des individus dont le statut juridique leur permette de se présenter librement sur le marché, pour y aliéner leur bien propre. La structure de la formation sociale, et particulièrement la structure de classe de la société, délimite ainsi le champ dans lequel les conduites économiques s’enchaînent et se répondent. Pour Marx, il n’existe pas d’« homo economicus », de sujet économique pur4. Celui-ci n’est qu’une abstraction : il n’a pas plus. de consistance que le pur sujet juridique, fondement du droit bourgeois. L’homme n’existe (à quelque niveau que l’on considère son activité) que pris dans le jeu et dans le système des relations qui constituent son existence sociale. Mais si la force de travail est une marchandise, elle doit, comme toute marchandise, avoir une valeur d’échange. Or, nous savons que la valeur d’une marchandise se mesure au temps de travail social moyen nécessaire à sa production. Il faut donc chercher, si l’on veut définir la valeur de la force de travail, à comprendre ce qu’il faut entendre par « production de la force de travail » et par « temps moyen de production de la force de travail »5. La première condition pour qu’une telle recherche soit possible est de savoir précisément ce qu’il faut entendre par les mots « force de travail ». Marx définit la force de travail comme « l’ensemble des facultés physiques et intellectuelles qui existent dans le corps d’un homme, dans sa personnalité vivante, et qu’il doit mettre en mouvement pour produire des choses utiles »6. Cette définition appelle quelques commentaires. On remarquera la dernière phrase. Marx ne dit pas « pour produire des marchandises ». Il écrit « choses utiles », lesquelles deviennent des marchandises selon que la structure de la société leur confère une valeur d’échange. Dans la mesure où le concept d’utilité est beaucoup plus large que celui de marchandise, le concept de force de travail apparaît comme une détermination dont le champ d’application déborde de beaucoup le cadre de la production marchande pour concerner toute espèce de production sociale. Cependant, comme marchandise, la force de travail est d’une nature particulière. Elle n’est pas une chose, comme un kilo de pain, par exemple, ou une maison, dont on peut suivre pas à pas tout le mouvement de production depuis les matières premières jusqu’au produit immédiatement utile. La force de travail est, dans le travailleur, « une capacité de produire », « une puissance ou une faculté de l’individu vivant ». Or, s’il paraît aisé de parler de la production et du temps de production du pain, il peut, en revanche, paraître difficile de parler du temps nécessaire à la production d’une « faculté humaine ». Mais cette difficulté ne doit pas nous arrêter, pour peu que nous sachions circonscrire exactement le problème posé et nous en tenir strictement à la donnée des termes dans lesquels il se pose. La force de travail est ici considérée sous la forme spécifique qu’elle prend dans le système capitaliste : la forme de marchandise, et dans cette forme nous sommes attentifs, pour l’instant, à la seule valeur d’échange. De même que la qualité de « chose » du pain a entièrement disparu dans la valeur d’échange de la marchandise « pain », de même la détermination anthropologique convenant à la force de travail doit disparaître dans son caractère de marchandise ; la seule « propriété » que nous ayons à retenir ici est la suivante : la marchandise « force de travail » doit pouvoir s’exprimer sous forme de fractions ou de multiples d’une marchandise arbitraire susceptible de s’échanger sur le marché ; et en cela rien ne la distingue du pain ou du fer, bien qu’elle ne soit à aucun degré une « chose ». ... comme toute marchandise, doit être reproduite D’autre part, si l’on est attentif au mouvement d’ensemble de la production, la valeur d’échange d’une marchandise est un moment nécessaire dans la réalisation de sa valeur d’usage. Une tonne de fonte, par exemple, s’échange sur le marché ; mais en dernière analyse cette tonne de fonte sera intégrée au procès de production et elle y réalisera sa valeur d’usage, elle servira, par exemple, de matière première pour la fabrication d’une certaine quantité d’acier. Il en va de même de la force de travail : son propriétaire l’offre sur le marché pour qu’elle y soit utilisée, qu’elle fonctionne en réalisant sa valeur d’usage pour produire des « choses utiles » ; et, en fonctionnant, en réalisant sa valeur d’usage, elle est consommée, usée, comme n’importe quelle autre marchandise. Et de même qu’une tonne de fer ne peut, une fois consommée, reparaître sur le marché que si elle est reproduite, de même la force de travail ne peut reparaître sur le marché (ce qui veut dire concrètement : « le travailleur ne peut subsister ») que si elle est reproduite. Nous disposons alors des données de notre problème. Si nous écrivons l’égalité : valeur de la force de travail = X, nous savons qu’en dépit de son indétermination présente, X doit, en valeur, représenter l’équivalent d’un certain quantum de marchandises. Nous ne savons pas encore en quoi consiste ce quantum. Mais nous pouvons commencer à le déterminer sans peine en observant que si la force de travail d’un individu a fonctionné pendant, par exemple, huit heures, elle ne pourra fonctionner le lendemain qu’à la condition d’être reproduite : le travailleur doit en réparer l’usure ; il doit se nourrir, dormir, et peut-être se distraire. Cette « réparation », qui n’est à vrai dire qu’« entretien » de la force de travail, exige du travailleur qu’il consomme des marchandises : nourriture, logement, etc. Ces marchandises ont une valeur d’échange en ce qu’elles représentent une certaine fraction du temps de travail social moyen nécessaire à leur production. Nous pouvons donc, sans risque d’erreur, commencer à déterminer X en écrivant : valeur de la force de travail = temps de travail social moyen nécessaire à la production de la somme des moyens de subsistance permettant au travailleur d’entretenir et de reproduire sa force de travail. Mais cette détermination reste incomplète. La force de travail ne fonctionne comme marchandise que dans le système capitaliste. Son usage permet à l’argent de se transformer en capital. Et cette transformation de l’argent en capital ne s’éteint pas avec la vie du travailleur individuel. Ce dernier s’use et meurt, mais sa fonction ne meurt pas ; elle dure aussi longtemps que dure le système capitaliste lui-même. Cela veut dire qu’à considérer l’ensemble du procès de production, si X propriétaires de force de travail disparaissent par « usure », le système ne peut continuer de fonctionner qu’à la condition qu’ils soient remplacés par un nombre au moins égal de travailleurs. C’est pourquoi Marx précise que par « reproduction » de la force de travail il ne faut pas seulement entendre l’entretien du travailleur individuel, mais aussi l’entretien de ses remplaçants éventuels, de ses enfants, pour que, dit-il, « cette race singulière d’échangistes se perpétue sur le marché »7. Nous compléterons donc notre formule en y ajoutant les moyens de subsistance des enfants du travailleur. Notre X est-il maintenant entièrement déterminé ? Pas encore. Nous avons considéré la force de travail au moment où elle s’exerce. Mais à ce moment elle est déjà quelque chose de bien déterminé. Le travailleur a appris un métier ; son éducation représente une somme d’équivalents en marchandises. Cette somme est variable selon la nature du travail considéré : elle peut être négligeable dans le cas d’un manœuvre et être très importante dans le cas d’un technicien. Il nous faut donc compléter notre formule en ajoutant l’équivalent en valeur des frais d’éducation. Dans la plupart des exemples utilisés par Marx, cette dernière fraction est tellement faible qu’il la néglige dans ses calculs. Ainsi la valeur de la force de travail est déterminée dans son concept de la seule manière qui soit compatible avec la théorie marxiste de la marchandise. Il resterait à chercher le moyen d’en fournir une expression quantitative à la fois fidèle et commode. Marx esquisse la solution de ce problème en un paragraphe du Capital8. Si l’on désigne par A la quantité de marchandises exigée quotidiennement par le travailleur, par B celle exigée hebdomadairement, par C celle exigée chaque trimestre, on définira la moyenne journalière de ces marchandises par le rapport :
- Se connecter pour publier des commentaires
- 5667 vues
Commentaire(s)
De l'émergence de la conscience révolutionnaire
Sans doute J.-T. Desanti a-t-il raison d’écrire que s’il peut engendrer des révoltés, « le vécu de la misère » « n’engendre pas spontanément des révolutionnaires ». Mais le problème est de savoir ce qu’il faut de plus à la conscience d’être exploité pour se transformer en conscience révolutionnaire. Suffit-il, suivant la solution spinoziste de J.-T. Desanti, de la prise de connaissance par les exploités du « mode d’engendrement et de reproduction des rapports socio-économiques qui font d’eux des exploités » ? La connaissance du mécanisme de la plus-value est-elle vraiment « décisive » ? En d’autres termes, la décision lui appartient-elle de produire une conscience révolutionnaire théorique et pratique – « théorique » ou clairvoyante sur la structure du système capitaliste et, dès lors, « pratique » ou tenue de « transformer ces rapports et d’en constituer d’autres qui ne reproduisent pas, en vertu du système où ils s’inscrivent, le mécanisme de l’exploitation » ?
Il y va là du problème de la liberté humaine dont Lagneau (dans son Cours sur le jugement) a montré qu’il n’avait reçu aucune solution absolue ni de Descartes ni de Spinoza. Si en effet l’on ne voit pas bien comment, selon la raillerie de Nietzsche, on pourrait parvenir à « se saisir soi-même aux cheveux pour se tirer du marécage du néant et se hisser enfin dans l’existence », on ne voit pas bien non plus comment, sans verser dans la divinisation d'un savoir fataliste et dogmatique, la conscience éclairée du réel pourrait résulter de la seule présentation des idées vraies à la raison ni, d’autre part, comment de cette seule présentation pourrait « se dessiner » une tâche de transformation du réel. Dans le premier cas, il manque à la connaissance la reconnaissance, et dans le second, au dessin un dessein. Pour m’en tenir à ce dernier, je dirai que si l’idée exorbitante d’un « projet de société », récurrente dans la pensée socialiste de ces quarante dernières années, me semble franchement ridicule, la « révolution sans utopie » est la véritable « utopie ». Le monde de l’après-marchandise, pour reprendre le slogan de Politproductions, n’est pas le simple « avenir » du monde de la marchandise. Pas plus que le présent n’est inscrit dans le passé, ce qui vient n’est lisible dans le présent. Pas plus que la connaissance ne résulte de ses conditions de vérité, l’engagement révolutionnaire de l’exploité ne dérive de la connaissance des conditions de son exploitation. Pour que se produise l’engagement il faut que la perpétuation de ces conditions soit en effet non seulement vécue, mais encore jugée comme plus insupportable que le risque attaché à leur renversement. Or ce jugement-là ne peut s’opérer sans pro-jet. J’y mets le trait d’union pour faire entendre le risque essentiel qui le traverse. Le slogan de Politproductions parle de la « pro-duction » et nous entendons autre chose que la reproduction. De même ici il ne s’agit pas du projet moderne, mais du se-jeter-à-la-rencontre-de-ce-qui-vient, dans le risque donc, bien qu’avec assez d’espérance sinon d’assurance. Or précisément, ce jour, si le mécanisme de la plus-value en tant que ressort essentiel du système capitaliste est assez généralement connu, si d’autre part il est également vécu comme insupportable, qui voit la possibilité d’un autre monde ? Serait-ce que l’analyse des conditions de l’exploitation n’a pas été poussée encore assez loin ? Ou bien ne serait-ce pas plutôt que manque toujours l’invention de l’autre monde ?
La question de cette invention ou pro-duction est sans doute celle qui anime ce site. Et je suis convaincu qu’il faut la poursuivre et la poursuivre notamment le long de la réflexion sur le travail. Et je suis également convaincu que ce n’est pas à partir de rien que la population se tirera du marécage de son néant politique ou « ne-gens » (même étymologie). Mais j’ai cru utile de rappeler que s’il n’y a pas en effet de « drame » chez Marx, que s’il a bien souligné dès sa Préface à la première édition du Capital qu’il ne s’en prenait pas à la personne du capitaliste bien qu’il ne l’ait pas « peint en rose », qu’il le prenait comme un agent du système capitaliste, au même titre en cela que le prolétaire, néanmoins ce qui retient le peuple en déshérence de descendre en masse sur les places publiques (pour répondre à un autre post sur Politproductions) c’est, non moins que l’obscurité de « l’après », la crainte du totalitarisme dont est gros le dogmatisme naturaliste que recèle également l’écriture de Marx. On lit par exemple dans la même Préface : « Mon point de vue, d’après lequel le développement de la formation économique de la société est assimilable à la marche de la nature et à son histoire, peut moins que tout autre rendre l’individu responsable de rapports dont il reste socialement la créature, quoi qu’il puisse faire pour s’en dégager ».
Comment et pourquoi (re)lire le Capital aujourd’hui
Invitation
Chers amis,
Vous le savez notre parti « Communistes » s’emploie à mener le débat et la lutte politique contre le capitalisme et pour l’émergence d’une société nouvelle dégagée de l’exploitation du travail humain. Dans une situation difficile, Nous estimons nécessaire de construire un parti révolutionnaire de lutte de classe. Cette ambition exige un travail militant et aussi un travail de recherche et d’étude pour mieux comprendre l’histoire et nos sociétés dans les rapports de classe que nous connaissons. Nous ne voulons pas remplacer le travail des chercheurs mais ouvrir une réflexion collective. C’est pourquoi, nous sommes à l’initiative de réunions et de débats publics. Le prochain auquel nous vous convions porte sur la lecture de l’ouvrage majeur de K. Marx : Le Capital.
Comment et pourquoi (re)lire le Capital aujourd’hui.
Ce débat sera introduit par un exposé d’Alain Bihr, Professeur Émérite de Sociologie, et auteur de plusieurs ouvrages sur le Capital :
La logique méconnue du Capital, Éditions Page 2, Lausanne 2010
La préhistoire du Capital, Éditions Page 2, Lausanne 2006
La reproduction du Capital, Éditions Page 2, Lausanne 2001.
Le débat aura lieu le mercredi 25 janvier de 12-14 heures à la maison des syndicats du campus de Jussieu (petit bâtiment préfabriqué d’un étage après l’Institut du Monde Arabe ), 23 quai Saint Bernard 75005.
D’ores et déjà, vous pouvez réserver cette date sur votre agenda.
Bien cordialement
Michel Gruselle
Responsable de « Communistes Université Recherche »
Pour tout renseignement complémentaire : michel.gruselle@orange.fr
En réponse à Comment et pourquoi (re)lire le Capital aujourd’hui par Polit'producteur (non vérifié)
Texte de la Conférence d’Alain Bihr
Lire sur Politproductions le texte de la Conférence d’Alain Bihr.